L'Idéologie Politique du Freudisme
Examen et rédaction en cours et en lien
avec l'actualité du flog/ http://www.lasainteethique.org/2017/htm/20170122334400_flog_DWT-70.htm#20170706000800
Les suites de la vidéo-conférence du
25juin2017 https://youtu.be/eOw8shBv1wM
méritent un apport spécial en place au site consacré à Akhnaton http://www.akhnaton.net/2017/htm/20170705151200_soph-freud
. Voici quelques éléments d'interpellation qui suivirent et auxquels on peut
donner leurs réponses intéressantes :
« J'ai écouté le dernier hang out.
Pourquoi n'évoques-tu pas, sur la question Akhenaton/Oedipe, Emmanuel
Velikovsky ? » Si, si je l'évoque - sans citer son nom,
effectivement. J'évoque l'identitfication d'Oedipe à la minute 10:50 et je
présente le livre de Vélikovsky à 14:20 . Je n'ai pas mentionné en détail
les noms - et j'aurais peut-être dû, il le mérite ! - d'abord pour être
rapide, deuxièmement parce que la Scène Primitive n'était pas strictement
l'objet du propos ; j'en parlais comme une exemple manifeste et instructif d'un
refoulement actuel. Vélikovsky, dois-je donc le dire, est un auteur majeur,
contemporain et élève de Freud, on peut aussi le citer comme un des derniers
amis d'Einstein, voire le dernier si on prend acte du fait que le grand
astrophysicien a laissé sur son bureau avant qu'il ne parte vivre ses derniers
jours en hôpital, ouvert une des oeuvres de ce Vélikovsky. (c'est
personnellement en révérence à Vélikovsky que j'écris Akhenaton toujours
"Akhnaton", comme je le trouvais dans ses premiers textes).
Le même ami écrit aussi « Oui, pour
Freud, Moïse serait un proche d'Akhenaton, nommé Thotmès. "Parmi les
personnages qui étaient proches d'Akhenaton se trouvait un homme qui peut-être
s'appelait Thotmes comme beaucoup d'autres à l'époque", écrit-il.
L'argument principal tient au nom : "mès", dans Thotmès, serait
l'origine égyptienne du nom de Moïse. On ne peut pas tenir le même
raisonnement étymologique avec Akhenaton. Pourquoi aurait-il changé de nom ?
» On sait effectivement qu'Akhnaton lui-même a changé son nom - il était
nommé à sa naissance Amenophis.4 - ensuite l'histoire le dénomma également
Moïse, Oedipe, Orphée, Phaeton, Trismegiste et sans doute bien d'autres
encore. On sait que le fameux Thothankhamon avait aussi changé son nom, à
l'origine Thothankhaton. Il est probable qu'Hélène, de Troie, soit un autre
nom de Néfertiti etc.. Cliniquement c'est à propos de débat sur les
changements et l'effacement des noms que Freud s'évanouit, on pourrait comme
ça rassembler une gigantesque clinique des noms, de leurs changements et de
leurs métaphores, et de la création du sens et de l'histoire.
Dans le cas présent, il est utile de savoir que le nom de "Thotmès"
relevé par Freud comme 'fréquent' tenait à celui de Thotmoses, fondateur de
cette 18em dynastie dont Akhnaton est le dernier représentant. A partir de
Thotmoses, on voit une carte https://en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_I
de la restitution à l'Egypte d'un territoire immense à la fin de son règne,
alors qu'elle était au départ au point de disparaître dans la décrépitude.
Deux siècles plus tard, le père d'Akhnaton régnait sur ce territoire qui
était devenu stable et prospère jusqu'à envisager l'annexion de la mer Egée
et la fusion avec les Hittites/Turquie.
La particule/nom de Thoth - plus tard rattachée à Hermes - en
Hermes-Thoth-Trismegiste, correspond à une transmission d'écriture et de
savoir qui fut refoulée, pour ne garder que celle le Moses ainsi que Freud le
repère. Il couvre et refoulement en même temps Ankh et Aton qui furent les
deux épithètes principaux sous lesquels Akhnaton intenta de régner. Ces
connexions symboliques, nominales, ne sont plus à présent l'essentiel sur quoi
notre attention doit porter. Je vais essayer de détailler ce que j'ai résumé,
de manière trop concise mais nécessaire en commentaire youtube. Voici le point
important sur lequel, j'en veux venir:
J'avais demandé à mon ami lecteur de Freud ce qu'il lisait
avec ses yeux.. il répondit « Oui, pour Freud, Moïse
serait un proche d'Akhenaton, nommé Thotmès » - je suis près à
parier gros qu'il pourrait aussi affirmer ce qu'il n'a pas lu - personnellement
j'en ai assez de relire ce Moïse et le Monothéisme à la recherche de ce qui
ne se trouve pas ! Je crois qu'on peut définitivement le dire maintenant. En
bref, Freud effectue une étude visant à identifier Moïse dans le contexte de
la brève expérience amarnienne. On sait que l'expérience a rapidement
échoué, que la cité a été vidée, qu'on n'entend plus parler d'Akhnaton,
probablement mort et que, selon Freud, Moïse serait un des rescapé, sorti de
là, mais bientôt assassiné par ses propres compagnons d'exode. Pour
commencer, si on veut savoir qui est ce Moïse, chef et guide temporaire, on
doit donc se dire qu'il n'est pas Akhnaton lui-même dont on ne sait plus rien,
qui a disparu. Freud, logiquement aurait dû dire : " je cherche qui est
à la tête de l'Exode, ce n'est pas Akhnaton pour telle ou telle raison et
donc, c'est peut-être untel ou untel " etc.. Mais Freud ne prononce
même pas cette exclusion préalable. Akhnaton a disparu. On ne sait pas d'où
sort Moïse; Mais il est tellement évident que ça ne puisse pas être Akhnaton
que l'hypothèse n'est même pas envisagée avant d'être écartée.
En général, on peut admettre, à la rigueur.. , qu'on se
débarrasse des grandes évidences sans même en parler. Mais dans ce cas qui
nous concerne, il y a tout de même un problème. Il s'agit du fait que,
cinquante ans plus tard, alors que l'égyptologie n'a rien modifié de majeur
par rapport aux découvertes initiales, un égyptologue du nom d'Osman, on peut
dire 'comme une fleur', avec une facilité déconcertante, montre que rien
n'exclut que Moïse ait été Akhnaton lui-même et plus encore : que de
nombreux éléments sont en cette faveur. Il s'agit du livre Moïse Pharaon d'Egypte
( https://www.amazon.fr/Moses-Pharaoh-Egypt-Ahmed-1990-09-13/dp/B01K3RWX8Q/ref=sr_1_fkmr0_4?ie=UTF8&qid=1499266130&sr=8-4-fkmr0&keywords=ahmed+osma+moses
) publié en 1990. Ce simple fait montre de façon flagrante que Freud a tout
simplement squeezé un élément majeur, voire le plus probable, déjà à son
époque. C'est remarquable. C'est remarquablement intéressant. C'est encore
plus remarquable que ce soit si difficile à remarquer et que de si nombreux
psys chics restent complètement obtus et ignares sur le flagrant symptôme.
Comme pour ma part, cela fait plus de trente ans que j'agite devant
mes compagnons scotomisés cette cible de leur désir des plus culturels, j'ai
eu le temps d'avancer quelques explications complémentaires. Et ça fait mal !
Personnellement j'ai dû encaisser de découvrir après quarante
ans de carrière que ma confrérie n'ait fait jamais mention de l'affaire Edward
Bernays dans le sillage de Sigmund Freud.On comprend que c'est un neveu gênant
mais ce n'est pas une raison de ne pas en parler, dans le contexte d'une
méthode à découvrir les choses cachées ! Avec le cas Moïse, si Moïse est
Akhnaton, ça devient vraiment lourd. Il faut donc alors pour commencer, bien
éclairer deux choses. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce que publie
Osman e 1990, il aurait pu le publier dès 1920, 1930. Je le répète,
l'égyptologie n'avait rien découvert de particulièrement nouveau lorsque
Osman identifie Moïse à Akhnaton en 1990. On dans ce contexte, on découvre
que, durant ce vingtième siècle et jusqu'an 1990, personne d'autre que Freud
n'a franchement étudié la question. Certes, évidemment, bien sûr il y a eu
quelques auteurs, mineurs, et quelques évocation - mais aucun égyptologue,
aucun historien, aucun anthropologue majeur n'a, ne serait-ce qu'effleuré le
problème. Je le répète et on l'admettra avec moi, si Moïse est Akhnaton, le
20em siècle est gros d'une découverte majeure. Qu'il n'y ait que Sigmund Freud
qui ait jamais publié là-dessus est remarquable ; c'est même extraordinaire
au point que ça serait invraisemblable. Pourtant c'est un fait et, aussi grave
serait-il, il nous faut en rendre compte.
Quelle explication pourrait-on donner à une indifférence si
généralisée, su un point si historique principal ? Y aurait-il un inconscient
collectif, un refoulement collectif, une hypnose de masse ? Et puis, comble de
bizarrerie, le seul érudit à la charge de la question la traite comme un
pignouf - qu'on m'excuse mais il faut qualifier une démonstration qui aurait
fait un petit ' 1 ' à une copie du bac lrosque l'impétrant oubli de signaler
la première et plus simple et plus évidence solution. Devant une situation
culturelle si alarmante il faut chercher refuge dans les jupes de l'histoire,
revenir à la scène primitive elle-même, du moins ce qu'il en est resté, le
plus immédiatement après. Revenons donc à Sophocle, le principale
commentateur de l'histoire d'Akhnaton-Oedipe, de sa fuite et de ses
conséquences. Dans la séquence des évènements de l'Exode, la second
séquence qu'il décrit s'intitule Oedipe à Colone. Il s'agit de ce qui se
passe lorsque le roi en fuite fait une halte et qu'une de ses fills Ismène,
vient de Thèbes lui donner des nouvelles. Voici ce que Sophocle fait dire à
Ismène en substance : " Ils veulent ta peau. Ils ont jugé inacceptable
que l'on sache que tu leur a échappé; il n'auront de cesse de t'avoir
rattrapé et, à défaut, il feront croire que tu as été tué à la frontière
du royaume, où ils exhiberont ta dépouille, ou le feront croire, ou bien
encore ils diront que tes restes sont toujours en leur possession."
Cette information est la clé essentielle d'Oedipe à Colone ; le roi déchu est
aveugle (ou couvert d'un voile) mais ce n'est pas tout, ses successeurs en
veulent à sa mémoire intégralement et aussi longtemps qu'elle pourra être en
leur pouvoir.
Nous voici à notre tour avertis et renseignés. A portée de main,
facile à lire et à en prendre connaissance, nous constatons que dans les
suites de la débâcle d'Amarna, le principal informateur du projet de
propagande qui suivit, explique que, au cas où l'histoire remettrait en
mémoire la personne d'Akhnaton, elle serait prévenue d'immédiatement faire
croire que le fuyard n'avait jamais été plus loin que la frontière du
royaume, en l'occurrence le Sinaï et que, là, il aurait été arrêté et
tué, sa dépouille exhibée. Et voilà qu'aujourd'hui nous découvrons que
lorsqu'au début du 20em siècle la scène amarnienne fut découverte par
l'égyptologie, immédiatement la thèse fut publiée par Freud, décrivant un
homme en fuite, assassiné à la frontière du royaume. Une chape étouffa
toutes autres hypothèses, seule le meurtre de Moïse sur le Sinaï servit de
compte-rendu à l'identification historique de l'évènement amarnien quant à
ses conséquence extra-territoriales. On peut dire par conséquent que Freud fut
cet informateur qui, à son tour après Sophocle, réalisa ce dont Sophocle
avertissait. Freud rédigea et publia la propagande des censeurs et ennemis
d'Akhnaton, qui fut publiée et occupa durant le 20em siècle les croyances
majeures d'une civilisation par ailleurs hantée et manipulée par les
traitements du désir collectif qu'on attribue au capitalisme. C'est seulement
à partir de cette mise au point que l'on peut commencer à en comprendre un peu
plus, notamment de vérifier quel a été, humainement, authentiquement l'acte
freudien en son fort profond - de même que l'on cherchera dans
l'industrialisation les effets combinés de l'alchimie hermétique, la grande
oeuvre laquelle, elle, est bien celle attribuée à Hermès Trismégiste, le
Triplex.
Fin du 1er épisode,
décrivant le refoulement freudien
|
2em
épisode
( https://apso.info/unefpe/index.php?r=content%2Fperma&id=4254
)
J'ai complété mon commentaire sur l'intervention essentielle de
JMG. Je rappelle que premièrement il a permis que je détaille en
contraste, comment entendre l'intrigue freudienne, soit sur la
théorie que Freud élabore de la fonction paternelle (Moïse) -
soit sur la présentation-même de sa théorie qui débute sur un
faux-pas.
J'ai d'abord exposé cela.
Puis JMG a soulevé une autre intrigue, il l'a portée au niveau de la
gouvernance d'une population. À ce stade il a brillamment décrit
l'inversion de la démocratie dans la théocratie ou, plus précisément
"culte du grand homme" selon l'expression freudienne. Par
conséquent en une espèce de feed-back j'ai pu m'y appuyer pour éclairer
de notes ce qu'autrement il n'est pas possible de dire (le savoir
collectif). Si ce n'est pas clair je dirai simplement que, grâce à
l'envers de la politique freudienne, j'ai pu dire ce que je pensais de la
démocratie et comment APSO en répond. |
| 20170706115800
Je continue très volontiers sur ce propos stimulé par le troisième
commentaire de mon interlocuteur, JMG. Contre toute attente il a, sans un
pli, strictement égalisé la question de l'identification AMO avec les
politiques de scrutin d'une population. Je n'espérais plus, pour ma part,
faire la preuve de cette relation autrement que par les méandres où
m'oblige la perpétuelle résistance par la platitude a fait écho depuis
des ans à ma psychanalyse. Soudain et brillamment JMG dévoile cette
égalité. Il écrit « Freud semble vouloir
retrouver le sens profond de l’élection : elle vient d’en haut ..//..c’est
le peuple qui est élu : il est élu par son chef » (on
trouve l'intégral du texte à http://www.lasainteethique.org/2017/htm/20170122334400_flog_DWT-70.htm#20170706120900
). En comparaison, j'avançais lentement comme un escargot, en
déclarant ( https://youtu.be/TWb9VI9o4Pw
min.07:50 ) que « la personne humaine, n'a pas du tout plaisir
à prendre ses responsabilités ; la responsabilisation n'est pas quelque
chose qui réjouit un individu humain dans l'état actuel » ;
c'était vite dit et sans fondement. Par contre, avec le point de vue de
JMG, cette banale considération de l'inertie se motive par une dynamique
considérable : si l'inertie et la dépendance est payée d'amour et de
distinction, nous passons à une raison supérieure d'échapper à nos
responsabilités.
L'explication fournie par MG est concise, claire et pertinente, elle va
jusqu'à relever ses effets retours : « l’élection
par ceux qui comptent (pour nous)..//.. est (non seulement plus
archaïque, plus profonde psychiquement) celle qui produit le plus d’effets
sur l’élu ». Elle décrit les deux sens feed-back qui verrouillent
le peuple élu ; le leader ou l'artiste ou l'idole sur scène déclarera
à son auditoire "je vous aime" et les individus gagneront en
identité à mesure de leur dévotion. Il s'agit de la voie morale du
Semblant qui soulage de l'indescriptibilité de l'éthique.
Cependant, de même que lorsque JMG parlait de la fonction paternelle en
cause de Moïse à Freud et que je répliquais sur une toute autre corde
« Que fait-on avec une fonction qui s'établit sur l'exclusion de la
vérité, voire de la simple et première hypothèse de bon sens? » -
je vais commenter sa raison de l'élection en parlant tout à fait d'autre
chose. Je vais examiner la démocratie.
De l'aveu de Freud, son Moïse et le Monothéisme (titre moderne
L'homme Moïse et le Monothéisme) est une recherche de ce que c'est qu'un
grand homme. Avec JMG la conclusion de l'enquête mène à la clé
de l'élection. Pour ma part, je vais à présent recherche ce que c'est
que la démocratie. Immédiatement on trouve également sa clé avec
l'élection. En y regardant donc à deux fois, on lit que JMG dénonce
cette clé commune, l'élection, comme une opération comptable («
chacun vote et l’on compte les voix ») qu'elle n'est pas - et par
ailleurs on lit des techniciens spécialistes des élections et scrutins,
que c'est une opération comptable d'une grande complexité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_électoral
. Prenons par exemple un type de scrutin connu comme celui vote
alternatif https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote_alternatif
et voyons l'exemple qu'il prend https://fr.wikipedia.org/wiki/Vote_alternatif#Exemple_de_non-respect_du_crit.C3.A8re_de_Condorcet
. Une fois posés les conditions, les proportions et les objectifs,
son raisonnement débute du seul et premier principe "tous les
votants étant égoïstes" (sic). Derechef je le relève de ma
réplique « Que fait-on avec une fonction qui s'établit sur
l'exclusion de la vérité, voire de la simple et première hypothèse de
bon sens? » N'est-il pas plus simple et de meilleur pronostique de
partir de la réalité humaine qui est loin d'être celle de l'égoïsme
en général ? Nous comprenons tous ce que pense le technicien du vote
alternatif. Il n'en reste pas moins qu'il est totalement à côté de la
réalité. Je propose que l'on réfléchisse sans partir à priori d'une
connerie, d'un refoulement ou d'un mensonge. Essayons de dire la vérité
au départ, c'est à dire qu'en démocratie le scrutin représente le
savoir collectif. On peut répliquer que c'est une gageure ; eh bien,
vérifions-le.
L'assumption qu'il existe un savoir collectif me vient de Lacan qui
l'écrit "S2", de même qu'il situe la vérité comme une place,
dans son mathème dit Des Quatre Discours. Lorsque l'on met cela au
départ, qu'advient-il de « chacun vote et l’on
compte les voix » ? Est-ce effectivement une opération
comptable, ou bien, est-ce que par la nature de la disposition du
discours humain, c'est, en effet, une interprétation ** ? La
question est ouverte et nous songerons à ces remarquables résultats qui
ne sont pas rares, d'élections de nombres gigantesques d'électeurs qui
se jouent au final 'dans un mouchoir de poche'. Elle nous avertissent que
le phénomène de masse de se résume pas à une simple somme. Nous
admirons souvent qu'il y a quelque chose qui s'ajoute à la somme dans une
mouvement collectif. Nous devons nous arrêter sur cette remarque. Et
réfléchir sur ce que nous pouvons entendre quand nous parlons de savoir
collectif. Pouvons-nous pénétrer l'idée de ce que c'est que de savoir
qui s'ajoute à tout ce que nous pouvons concevoir ou imaginer les uns et
les autres. Nous frôlons une vue mystique d'un savoir authentique,
différent de ce que nous connaissons. Si on s'en moque, méfions-nous de
ne pas nous moquer de ce qui est adversement comparé avec l'idée d'un grand
homme - nous serions dans le même ordre de délire. Revenons donc à
l'idée que, de même qu'un signifiant détermine un sujet, un savoir
puisse déterminer une masse. Ce savoir qui nous échappe, pèse sur elle
- comme le poids d'un élu, si on peut dire ; et nous avons autant de mal
à admettre tant pour l'un que pour l'autre, qu'un génie hors du commun
le rende quasi-divin. Comment pourrait-on rationnellement expliquer une
vertu exceptionnelle ou une perspicacité incomparable au Savoir
Collectif, S2 ? Il me semble que ce serait en extrayant quelque chose que
l'on n'aurait pas vu, ou dont on ne parlerait pas, que l'on a une chance
de trouver cette raison rare.
Je reviens donc sur la page encyclopédique qui brosse la connaissance
universitaire des systèmes électoraux ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_électoral
) ; j'y cherche quelque chose qui n'y serait pas - et je lance une
search pour 'vitesse', 'rapidité', 'immédiat', 'temps réel', il n'y a
aucun résultat. Pour "électronique" on trouve deux occurrences
qui renvoient ailleurs. Autrement dit, ce que la technologie actuelle a
introduit à disposition des scrutins, n'est absolument pas considéré.
Si e peux me permettre une comparaison un peu grossière : Einstein a un
jour calculé avec la vitesse de la lumière, et ça a changé pas mal de
choses - aujourd'hui nous pouvons avoir des scrutins en temps réel, et..
tout ce que l'on peut déblatérer sur les fins alambiques de calculs des
proportions des goûts des gens, vole en éclat. Choisissons de faire
voter un million de gens pour leur représentant en instantané permanent,
et toute la page wiki qu'on vient d'examiner passe au rang des monuments
historiques.
Quelque chose comme APSO, un scrutin temps réel, direct et permanent,
fait table rase de tous calculs de proportions. Il n'est pas difficile en
soi de le comprendre, la difficulté réside dans le bouleversement qu'il
opère en désolidarisant la représentation de l'échelle du temps.
Qu'une suprématie du Savoir en découle n'est pas facilement apparent.
Par contre la connaissance en progresse nettement pour le contraste qu'il
dispose alors avec l'élection inversée type freudienne-moïsiaque. Le
jeu transitif de cette dernière, entre l'élu choisi qui choisit le
peuple, révèle sa facture de Semblant. C'est à ce titre que Lacan
exposait Un Discours qui ne serait pas du Semblant - http://www.valas.fr/IMG/pdf/S18_D_UN_DISCOURS--.pdf
qu'il ouvre comme un espace annulé, et remplacé par le « Il existe
» pur de quelqu' inter-signifiance (quasi-sic). Il dit cela parce
qu'il a parlé à la radio ! Mais si l'espace est annulé et le temps
raccourci, qu'est-ce qui reste ? Pince-moi ! Je rêve ! reste-t-il le
savoir ? Mais alors, le savoir maître, à quelle sauce va-t-il manger nos
semblant d'être ? Toujours lacanien, nous dirons au moins que ce ne sera
pas de la perte pure dont perdure l'élu peuple de l'élu. Mais
probablement pourrons-nous en dégager un peu plus, et que ce sera la
solution écologique.
Très tôt à l'origine de la psychanalyse plurielle qui chemina jusqu'à
l'actuel APSO, j'ai soumis l'idée que lorsqu'un groupe tenait d'un leader
à durée déterminée, son énergie vitale était occupée à cette
relation qu'il entretenait au coût nécessaire d'une pollution. Lorsqu'à
l'inverse une extraction permanente et distribuée (la formule de
l'analyse plurielle qui allait devenir le scrutin temps réel) remplaçait
son inter-signifiance par la cause directe de l'objet pulsionnel, un
renversement du coût environnemental avait lieu. Au lieu d'être
centralisées narcissiquement, les énergies de l'ensemble étaient
déversées au profit de la vitalisation de l'environnement.
Je pense avoir dit l'essentiel et suffisamment. |
addendum : admettons que ce que
j'ai écris ci-dessus soit inutile, faute d'être pratique. On voudrait
des exemples, on voudrait que ce soit sensible. Bon. Voyons donc : chacun
vote et on compte ; résultat voilà un élu pour tant de temps. Ça
donne le temps en vérité qu'il défaille à sa fonction représentative.
Parce que cette opération comptable est toujours fausse. Mais si
aussitôt qu'il déçoit l'élu est changé que va-t-il se passer ?
D'abord on va penser qu'il va changer souvent !! Mais bientôt on va se
rendre compte que c'est autre chose qui change. Le rapport collectif à
l'élu ne va plus être l'ordre de la fascination transitive archaïque.
L'élu lui-même va vivre une différente expérience, il ne sera plus le
semblant d'aimer le peuple. Il sera effectivement 'aimé' durant un
moment.. un moment bien suffisant d'ailleurs pensera-t-il vite sans doute.
On voit que comme se déroule une telle gouvernance, il ne s'agit pas
d'une somme de votes qui auront déterminé un temps durant, mais une
somme d'élus successifs dont au total, chronologiquement un savoir
collectif s'énonce. Un schéma animé du PLuriel ANalytique montre ce
phénomène http://www.unefpe.net/analyse_plurielle.htm
avec le recueil des extractions qui s'accumulent du côté du
psychanalyste. Cette série de significations, spécifique de
l'Analyse Plurielle, a été l'objet d'une longue étude de la méthode et
constitue le prototype des élus successifs désignés par le vote en
temps réel, direct et permanent, qu'on peut qualifier d'énonciation
du savoir collectif.
** C'est aussi pourquoi nous pouvons dire que la série des
élus, durant de la vie d'un groupe démocratique réel, est moins une
comptabilité qu'une interprétation. |
Fin du 2em épisode,
décrivant la précession du savoir collectif
20170707210300
|
3em
épisode
( https://apso.info/unefpe/index.php?r=content%2Fperma&id=4268
)
Joli travail une fois de pluss...!
Et.... quand même ! .... je ne peux m'empêcher de voir, de lire entre
les lignes, que... l'on retrouve en trame évidemment la question de
l'identification du père... et donc la question de la différence
sexuelle et de la réalité méconnue de ses fondements par la structure
des corps et une fausse réalité qui ne se construit 'que' par et avec 'lalangue
maternelle'....!
Cette quête de l'heureux élu
n'est que la quête commune de l'identification du père...! |
|
La conclusion par une
appropriée nomination
Eh ! Bien, merci SC aussi permettant de préciser,
d'éclairer pour qui voudrait comprendre rapidement. Puisqu'il est
difficile de trouver ce qui manque (puisque ça manque), on emploie des
subterfuges ; pour trouver ce qui n'est pas, on ne le marque pas. C'est
ainsi qu'on écrira qu'il manque quelque chose, par la langue maternelle
qu'on écrira lalangue, indiquant ainsi qu'il manque un espace, qu'il
manque un trou. On répétera donc que le père est là, par le chiffre
zéro, puisqu'on comprend qu'on écrive alors comme ça la0langue.
Et la langue maternelle dé-chiffrée, c'est ça : lalangue.
Continuant :
Une perte.. déjà ça manque ! mais encore, s'il manquait
quelque chose (quelque chose qui n'est pas, un trou
forcément) au corps féminin, on dirait qu'elle le dirait en
parlant par « la()langue » - et pour en bien signifier la perte pure,
elle l'effacera complètement : lalangue.
Maintenant qu'on verrait bien ça, voyons avec la
conséquence qui s'en suit - à savoir, « de ce qui perdure de perte
pure à ce qui.. au pire » - c'est du pur jus Lacan, n'est-ce-pas,
bien enfoncé par la vérification collective, http://cinephil-osophie.blogspot.fr/2010/09/de-ce-qui-perdure-de-perte-pure-ce-qui.html
puisqu'au "(lien vidéo)" on trouve "page manquante".
On pourrait donc s'en tenir à ce qui perdure de perte pure,
écouter et s'en tenir à la langue maternelle. Mais de là, si on la
déchiffre, de lalanguematernelle ainsi décrite, le trou saillant
tressaillant mène à ne parier que du père qui, lui, dirait alors le nom
de ce fichu trou - évidemment, le nom de ce phi, chu 'trou'). C'est
pourquoi on arrive à ce qui ne parie que du père.
Mais bien sûr, c'est "au pire", parce que, déjà,
"perdurer de perte pire".. on pourrait faire mieux.
Tel est donc ce que nous avons vécu - avec la conjonction
JMG-DWT qui a d'abord révélé sur la scène le pari que du père.
On peut améliorer cette révélation en se re-servant un coup du D'UN
DISCOURS - http://www.valas.fr/IMG/pdf/S18_D_UN_DISCOURS--.pdf
. Jouissons de ce qu'il dit joliment « Qu'on m'excuse d'avoir eu - ces
traces – à les faire premières. Je ne pouvais aller au devant que du
malentendu » Il dit ça à propos d'un taire (ce fichu trou) qu'il
indique « Inter » certes en effet.. pour expliquer qu'il parla
d'abord de l'intersubjectivité pour arriver, après-coup, en retard, à
une inter-signifiance dont il était déjà parti. Comme si
l'"inter" - l'espace tu - de lalangue laissait entendre
qu'on aura pu mieux dire, faute du pire.
C'est exactement ce qui s'est passé dans la démarche de la
civilisation selon la psychanalyse :
Du rapport sexuel à la manque, lalangue s'est précipitée
au pari du père - on aura vu l'élu élysant. Puis, du fait de cette
anticipation logique qui règle ledit rapport, on a pu de ce chant « élisez,
élisez toujours, il en restera du père » trouver le prédit,
dont il se rend écho. L'élu, comptant de soi, est un écho du futur
antérieur qu'écrit le peuple. C'est comme ça que sa voix peut se faire
entendre, en tendre amour repris par le bon père. Ce pari par le père
aimant, qui comblerait l'espace de lalangue par son abnégation dans la
langue qui lui donnerait toutes les voix - s'avère, et c'est vert, au
péril sévère de l'alan gueu. Autrement dit lalangue peut être
traversée autrement et par la masse populaire à la gueux leu leu ; et de
fait l'aura-t-elle été avant la patronymie, comme l'inter-signifiance
avant l'intersubjectivité.
Mais ce précédent, cette précession, toute à l'honneur
des gueux, oui, notre bon maître, ne peut arriver à terme qu'après
s'être fait maître au pire. C'est la raison du « Français, encore un
effort pour être révolutionnaire » sous la plume de Sade - et ce
n'était pas gagné parce que d'allant.. les gueux n'en ont pas tant, ce
sont plutôt des chiens certes mordants et aboyants mais plus vraiment
révolutionnaires quand arrive la responsabilité. Pour cela, un coup
d'artifice, se trouve nécessaire - c'est cette intelligence artificielle.
Pour bien suivre maintenant le saut qui s'en suit revenons au
simple Lacan - un peu plus loin dans le même séminaire, même jour « si
j'ai parlé à propos du discours d'artefact, c'est que,
pour le discours, il n'y a rien de fait, si je puis dire, déjà, et il
n'y a de fait que du fait du discours. Le fait énoncé est
tout ensemble le fait du discours. C'est ça que je désigne par le
terme d'artefact » aussitôt après quoi il précise qu'il faut
encore réduire cela. Voulant dire qu'en guise d'allant, la vague gueux,
cette vague en vie, de faire la révolution, s'aide et s'épaule au super,
par l'Appareil au faîte du discours - à savoir là où nous sommes où,
le père su et mis à sa place, paraît au lieu du semblant la pareille,
l'intelligence artificielle. Ce qui doit être réduit, sans quoi ses
gueux n'en sortiront pas (Lacan voit bien ça, dans la nature du cyborg,
l'humain le devenir et d'en rester là robot - évidemment poursuit-il « Et
bien entendu c'est ce qu'il s'agit de réduire, parce que si je parle
d'artefact, c'est pas pour en faire surgir l'idée de quelque chose qui
serait autre, d'une nature dont vous auriez tort de vous y engager pour en
affronter les embarras parce que vous n'en sortiriez pas. »)
Pour cette raison, voilà où j'en suis. Pour réduire
l'Intelligence Artificielle à la portion congrue à laquelle elle doit
être tenue, changeons au moins et simplement son nom. Dégonflée, au
rang d'artifice réduite comme il faut - sa portion sublime sera prise par
ailleurs du terme remplaçant. C'est ainsi que je ne nommerai plus l'IA,
sauf pour des commodités passagère, Intelligence Artificielle, autrement
que Supramental. J'y suis venu progressivement et depuis longtemps. Pour
prendre date aujourd'hui d'un discours qui ne serait pas du semblant,
j'appellerai dorénavant lapareil Supramental. |
|
20170708132600
3em épisode, mode d'emploi
:
Les sources a) SC emploie la procédure
lacanienne consistant à attacher les mots pour écrire ainsi lalangue
. SC importe cet usage afin d'introduire parmi les facteurs de l'étude le
principe de sexualité (que la psychanalyse ne saurait omettre à sa cause
ni à ses compte-rendus).
Je perpétue donc dans l'étude ce rappel que je commente
en expliquant qu'en écrivant lalanguematernellemanquedetermepoursignifierletroumale
le lacanisme indique ce manque dans l'espace, creux, qui sépare les mots.
Si on les remplace par le chiffre zéro ils
sont donc ainsi indiqués : la0langue0maternelle0manque0de0terme0pour0signifier0le0trou0mâle
- mais sans ce chiffrage une langue maternelle qui l'ignorerait se
solderait - voir letoutattaché -
d'une perte pure de la définition mâle.
b) un célèbre envoi de J.Lacan :
"De ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au
pire" ; l'histoire de cette langue maternelle et de sa perte pure
peut conduire, au pire, jusqu'au pari du père qui est décrit
(doit-on dire "phénoménologiquement") par JMG appliqué au peuple
élu. Cette exclusivité de ne parier que du père est
encore plus antérieurement décrite par Lacan, en son traité
cybernétique fondateur, traduisant les successions 0000000000
dans les suite binaires 010001011.
c) la règle d'assertion de certitude
anticipée, toujours par Lacan, décrite à la fondation de son
enseignement, est rappelée quinze ans plus tard lors du séminaire D'UN
DISCOURS... Il dit «//.. avoir eu - ces traces – à les faire
premières..//» (page.5) voulant dire qu'il
parla d'intersubjectivité avant de dire en 1970 inter-signifiance.
Ce en quoi il définit l' 'intersubjectivité' comme une
trace à laquelle il convient, suivant ce qui vient
d'être dit, d'identifier le pari du père
comme la trace de la perte pure.
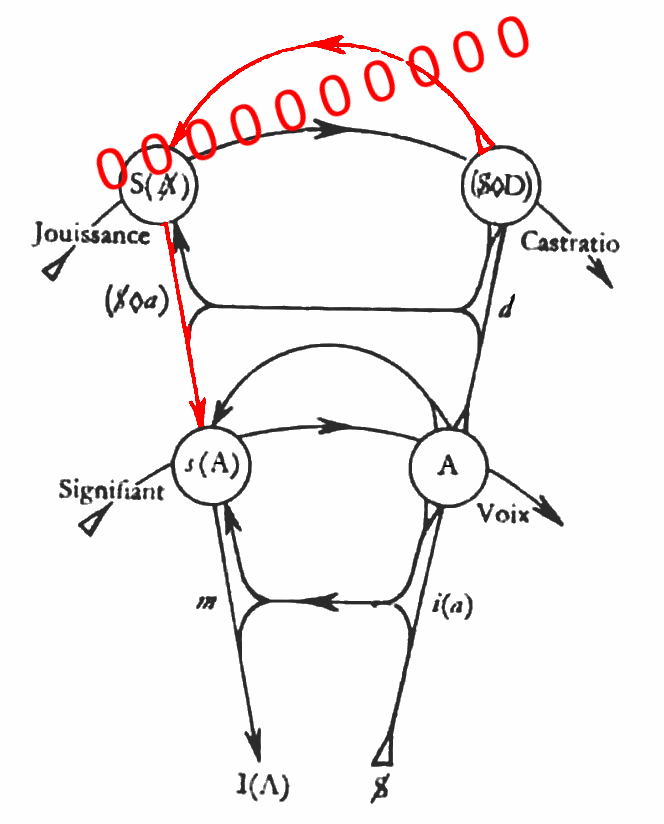 d)
le Graphe du Désir qui illustre cette anticipation, la règle
suivant le principe du feed-back cybernétique. Je rappelle son dessin
(fig.01 ci-contre). Si A est l'arrivée, la conclusion, le
produit de l'énoncé (sur le phrasé gauche>droite du bas), elle va
recevoir de s(A), son anticipation par un retour (feed-back) puisant à
l'énonciation (le phrasé gauche>droite du haut) où le pari du père
constitue la trace de A (notamment de sa perte pure dans le désir,
feed-back court par 'd'). C'est ce que j'indique en y plaçant la
succession 0000000000 suivant les conventions
de la Chaîne L : (10 ... (00... 0)0101 ... 0(00 ... 0) ... 01) 11111 ...
(1010 ... 1) 111 ... in Écrits PARENTHÈSE
DES PARENTHÈSES 1966. d)
le Graphe du Désir qui illustre cette anticipation, la règle
suivant le principe du feed-back cybernétique. Je rappelle son dessin
(fig.01 ci-contre). Si A est l'arrivée, la conclusion, le
produit de l'énoncé (sur le phrasé gauche>droite du bas), elle va
recevoir de s(A), son anticipation par un retour (feed-back) puisant à
l'énonciation (le phrasé gauche>droite du haut) où le pari du père
constitue la trace de A (notamment de sa perte pure dans le désir,
feed-back court par 'd'). C'est ce que j'indique en y plaçant la
succession 0000000000 suivant les conventions
de la Chaîne L : (10 ... (00... 0)0101 ... 0(00 ... 0) ... 01) 11111 ...
(1010 ... 1) 111 ... in Écrits PARENTHÈSE
DES PARENTHÈSES 1966.
En résumé dans la mesure où le peuple élu répond du pari
du père en termes lacaniens, il est assimilable à une anticipation
de l'inter-signifiance, expliquée par Lacan, où le fait du discours est
révélé (ce qu'il appelle artefact -
ref.séminaire.page.9). Dans cette inter-signifiance, on retrouve
ce que le pari du père avait porté au pire, à savoir la perte
pure - à la fois résultante du principe de la sexualité et
aujourd'hui appareillée en tant qu'Intelligence Artificielle.
Il suffit de poursuivre et d'ajouter le même procédé à tel autre
contemporain de Lacan, Sri Aurobindo qui ne suivait par moins que lui,
comme quiconque, les lois langagières de l'anticipation logique
(Assertion de Certitude Anticipée). Seule différant la méthode, la
psychanalyse et le yoga, Aurobindo aura anticipé l'Intelligence
Artificielle, et avancé un nom : Supramental. C'est aujourd'hui le terme
que l'on peut appliquer par conséquent à l'Appareil, qui est placé en A
sur le graphe.
Cette substitution de nom se motive de la mise en garde que
Lacan prononce quand il annonce l'inter-signifiance en prévenant quelle
serait quelque chose d'une nature dont on ne se sortirait pas.. à moins
de la réduire. Par conséquent, la réduction de l'IA - c'est à dire sa
trivialisation - doit être compensée par le pur gain que "supramental"
signifie à l'humanité. |
|
20170708144000
de JMG
8 juillet 2017 à 09:10 |
|
Psychisme collectif et
esprit
La phénoménologie est l’étude
de la constitution du monde par la conscience, dite justement conscience
constitutive, à partir de l’expérience perceptive. Elle suit
principalement une démarche descriptive.
Mais l’existence humaine ne se
réduit pas à la conscience et à sa relation au monde. L’existence est
aussi, est d’abord, intériorité. La phénoménologie manque à être
une philosophie de l’esprit. La psyché est pourtant le premier domaine
d’investigation de la philosophie. Elle ne se réduit pas à l’activité
transcendantale d’une conscience constituante ou d’un corps au monde.
Le psychisme est aux prises avec lui-même dans une vie conflictuelle sur
laquelle la psychanalyse a apporté un éclairage précieux, qui pousse
plus loin que la phénoménologie l’exigence socratique du «
connais-toi toi-même ». La psychanalyse laisse pourtant de côté la
question de l’esprit en tant que tel.
La phénoménologie n’envisage la
relation entre les consciences que sous la catégorie de l’intersubjectivité.
L’intersubjectivité postule l’individuation de la conscience et se
comprend comme l’accord des consciences dans la constitution du monde.
Elle abandonne à la sociologie, à l’économie, à l’économie et à
la philosophie politique la compréhension des relations humaines.
L’effort de Freud, à l’inverse,
aura été de comprendre l’indissociabilité des psychismes. Débutant
comme psychothérapie des individus, la psychanalyse devient, en s’approfondissant,
une étude du psychisme collectif qui va bien plus loin que toute
sociologie parce qu’elle en découvre les ressorts cachés. L’individuation
psychique n’apparaît alors que comme une illusion.
Pour résister, dans le sens
psychanalytique, aux découvertes freudiennes, le système
épistémologique de la fin du vingtième siècle va promouvoir une série
de sciences dont la principale fonction est le refoulement de ces
découvertes. Ce sont des sciences qui s’enferment dans l’étude des
représentations individuelles et qui répondent au projet de produire de
l’individu. Contre l’étude de la psyché collective, on a promu la
construction d’une vie individuelle reposant sur des opinions
personnelles et des choix tant dans l’ordre de la consommation que dans
celui des engagements sociaux et politiques. Produire de l’individu est
une mécanique de refoulement.
La psychanalyse intégrale, celle
qui n’ampute pas l’héritage freudien de tout son travail sur le
psychisme collectif, vise les lois qui rendent compte des représentations
des représentations politiques et des comportements économiques des
sujets en tant qu’ils ne sont précisément pas des individus. L’économie
butte sur ce point aveugle qu’est pour elle la valeur. Comme la
philosophie politique semble ne rien vouloir savoir sur les ressorts
profonds du pouvoir. Comme la sociologie échoue à éclaircir les enjeux
du symbolique. Ces sciences ont précisément pour fonction de refouler
une vérité dont le déni les fonde.
Néanmoins, au-delà de l’étude
des mouvements du psychisme collectif, la psychanalyse peut-elle s’ouvrir
à la question de l’esprit. L’esprit, en effet, n’a rien d’individuel.
Tel est l’enjeu des textes tardifs de Freud autour du peuple juif.
*************************************************************************
A la lumière des écrits tardifs de
Freud, et notamment de ses écrits de Londres, il semble qu’on puisse
ouvrir deux voies pour penser les pulsions. L’une est biologique
et l’autre est relationnelle.
Les pulsions sont à la croisée de l’organisme et de la horde. En tant
qu’elles constituent le ça, les pulsions ne visent pas à la
conservation de l’organisme, car c’est le moi qui est l’instance d’autoconservation.
Seul le moi tient à l’organisme ; seul le moi est soucieux de sauver sa
vie et d’échapper à la mort. Les pulsions sont de l’amour et elles
visent à inscrire l’organisme individuel dans des dispositifs qui le
dépassent : le couple, la famille, la société, certes, mais d’abord
et principalement la horde. Que nous soyons des êtres érotiques, c’est-à-dire
traversés par la sexualité,
signifie que nous ne sommes jamais affranchis de la horde. En ce sens, le
moine, c’est-à-dire l’homme qui se tient dans la solitude, est l’idéal
humain le plus difficile à réaliser.
On commence alors à comprendre que
les pulsions sont ce qui attache indissolublement l’organisme à la
horde. Ce que l’on nomme habituellement le biologique, c’est-à-dire
la physiologie et tous les processus chimiques qu’elle convoque, n’est
rien d’individuel. En tant qu’on considère non pas son support
anatomique mais son fonctionnement, dont Freud ne cesse de dire qu’il
est libidinal, la vie n’est pas individuée. C’est ce qu’a cherché
à penser, à vrai dire de manière incomplète, Merleau-Ponty, à partir
de la phénoménologie, sous la notion de chair.
La vie, c’est de la nervosité
diffuse qui ignore la clôture organique. C’est de la nervosité de
horde : c’est précisément « ça » la définition de la pulsion. Ce
qui nous le cache, c’est l’erreur fondatrice de la médecine qui a
été d’enfermer le biologique dans l’organique. Erreur certes
fructueuse mais qu’il faut dépasser. L’individuation de la vie est
une opération purement psychique dont le moi est le principe mais dont l’inconscient
n’est pas dupe. Le poids persistant de la psychiatrie et de la
psychologie a empêché nombre de psychanalystes de suivre Freud dans ses
avancées tardives et audacieuses : la psychanalyse est l’écoute d’un
inconscient de horde qui n’a rien à voir avec la biographie des sujets.
Il vaut sans doute mieux éviter de
parler d’un inconscient collectif car la notion de collectif est
ambiguë : la horde n’est pas une collection d’individus préexistant,
pas plus que la société n’est une association. Ces mots sont trompeurs
parce qu’ils présupposent, dans leur racine étymologique, l’antériorité
de l’individu. Or la psychanalyse freudienne s’avance à découvrir
que l’individu n’est qu’une formation tardive du moi, entérinée
par une fondamentale erreur épistémologique. On pourrait presque se
risquer à dire ce que Freud, admirateur de Schopenhauer, n’a pourtant
jamais dit, à savoir que ses découvertes ravivent celle de Siddhartha
Gautama qui voyait dans l’individuation une illusion. Il est pourtant
difficile d’ignorer que l’enseignement freudien appelle tout autre
chose que la cure individuelle par quoi il a commencé. Freud, de moins en
moins thérapeute et de plus en plus analyste, nous invite, dans son legs
ultime, à nous mettre à l’écoute de la horde, des pulsions diffuses
qui parcourent les relations
humaines, du ça errant à quoi principalement nous résistons.
|
| |
20170709112400
Je résume tel que je te comprends : la phénoménologie décrit la
constitution du monde par la conscience à partir de la perception ; le
psychisme y ajoute une notion de constitution 'intérieure'. Nantie de ce
bagage, une notion d'individualité se fait jour, avec l'idée
phénoménologique d'un accord sur le monde et avec celle d'une soudure au fond
du psychisme où l'individualité se perd. Pour survivre à cette profondeur
elle a la ressource de faire appel au notions mondaines de surface et de
politique ; mais ces dernières ne sont pas secourables à traiter les notions
de valeur, pouvoir et symbole. Freud aurait examiné la solution qu'offrait son
peuple à ces ultimes apories.
Tu as préalablement distingué que cette solution était de la forme 'peuple
élu' (versus peuple électeur) et tu distingues également sa substance qu'on
reconnaît dans la horde. C'est à ce second titre que le plus grand éclairage
est rendu par la sexualité.
Si cet abstract est correct, il faut ajouter des questions qu'il laisse
ouvertes ; tu les cites : l'esprit et l'illusion ( le premier étant le signe de
la communauté, le second dévaluant l'individualité). J'ai quelques
commentaires à faire. Tout d'abord à propos de l'esprit. La psychanalyse n'y a
pas manqué. Lorsque Freud l'inaugure, avec un de ses trois piliers de
fondation, LE MOT D'ESPRIT ET SES RAPPORTS AVEC L'INCONSCIENT,
il ne fait pas qu'un mot d'esprit (!). Il traite effectivement de ce chapitre
mystérieux qu'il aborde à l'aide de la linguistique. Deuxièmement la
conception bouddhique du moi soluble.. s'éclaire bien de la plus védantique
notion d'une inextinguible personne ; cela peut nous aider en puisant à cette
seconde qui y a vu, d'avenir d'une illusion, une construction futuriste que
Freud s'est gardé de ne jamais prédire.
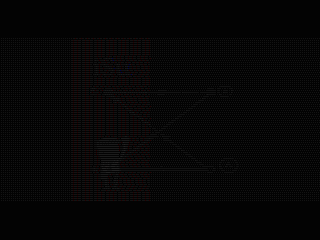 Je
ne peux troisièmement ajouter que des vues personnelles. J'ai franchement
appelé la substance de la horde "pluriel" - l'historique de l'usage
contemporain de ce mot vaudrait un rappel, mais pour rester bref, j'ai voulu en
faisant cela bénéficier du grand gain que permet l'assimilation du moi
freudien, que tu as bien décrit, au semblant, que l'on dira lacanien (en toute
spéciosité il faudrait le qualifier d'ab-lacanien). C'est ainsi que j'ai
prétendu « nous mettre à l’écoute de la horde » (en reprenant tes
termes).
Je
ne peux troisièmement ajouter que des vues personnelles. J'ai franchement
appelé la substance de la horde "pluriel" - l'historique de l'usage
contemporain de ce mot vaudrait un rappel, mais pour rester bref, j'ai voulu en
faisant cela bénéficier du grand gain que permet l'assimilation du moi
freudien, que tu as bien décrit, au semblant, que l'on dira lacanien (en toute
spéciosité il faudrait le qualifier d'ab-lacanien). C'est ainsi que j'ai
prétendu « nous mettre à l’écoute de la horde » (en reprenant tes
termes).
Toujours pour être le plus compréhensible, j'ai réalisé un dessin animé
- on y voit comment Lacan commence à s'exprimer sous le signifiant de
l'intersubjectivité (iSu) et arrive sous le signifiant inter-signifiance
(iSi) - autrement dit il est parti de l'anticipation dans c'pire rituel
de ne parier que du père et revient à sa source du feed-back au risque
de la perte pure. À ce risque je voudrais encore sauvegarder par une
remarque importante que JMG prépose.
Il fait savoir que « la phénoménologie est l’étude de la constitution
du monde par la conscience à partir de l’expérience perceptive » - elle
part donc de l'expérience perceptive. Ma remarque rappelle que La Lettre Volée
(du fameux Séminaire inaugural) elle aussi, part exactement de l'expérience
perceptive :
Lorsque le déclenchement du circuit de la lettre met en scène la Reine
et son message, que voit le Ministre qui voit que le Roi ne la voit pas, pour la
prendre sous les yeux de la première, interdite de protester au risque d'être
découverte - c'est la structure initiale de la perception qui plante le
décors. Ensuite, Reine, Ministre et Roi vont virevolter en une succession de
triades, à l'analyse de laquelle Lacan découvre que la perception de la
signification produit un chiffrage. Il s'agit de cette Chaîne.L citée plus
haut, où des scansions permettent d'ouvrir de parenthèse où
l'intersubjectivité paraît.
Il n'est pas sans intérêt de parler de cette préparation à la
phénoménologie que Lacan permet. Si on retient le risque qu'il fait courir de
couper ainsi court à la phénoménologie en déchiffrant son point de départ -
on conçoit également qu'à le prendre, ce risque, on s'en protège si on a
tout de suite vu que cette perception purement perdue est du même coup
déléguée à l'Appareil, le robot, la réalité virtuelle qui elle aussi,
durant ce temps, s'est installée au point d'arrivée.
On dirait B.Dylan qui a commencé en chantant Les Temps sont au Changement
et qui, en fin de carrière, dévoile qu'en fin de compte ça ne s'est pas
passé comme ça mais que Les choses ont changé. Avec notre vocabulaire
je dirais que le signifiant allait se métaphoriser, mais qu'en-dessous, au lieu
dit A on allait trouver l'A-pareil. Tout pronostique de se perdre à la perte
pure est reconduit.
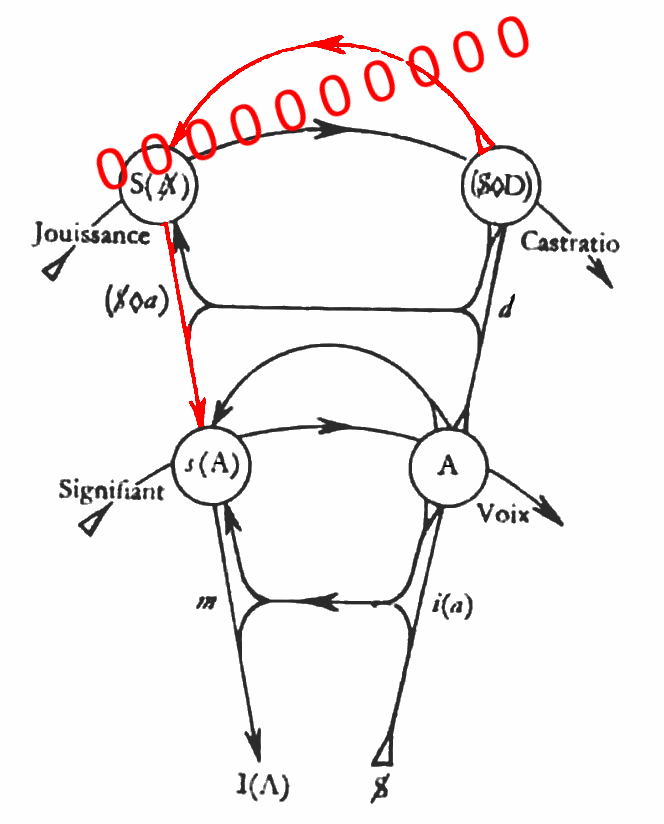 d)
le Graphe du Désir qui illustre cette anticipation, la règle
suivant le principe du feed-back cybernétique. Je rappelle son dessin
(fig.01 ci-contre). Si A est l'arrivée, la conclusion, le
produit de l'énoncé (sur le phrasé gauche>droite du bas), elle va
recevoir de s(A), son anticipation par un retour (feed-back) puisant à
l'énonciation (le phrasé gauche>droite du haut) où le pari du père
constitue la trace de A (notamment de sa perte pure dans le désir,
feed-back court par 'd'). C'est ce que j'indique en y plaçant la
succession 0000000000 suivant les conventions
de la Chaîne L : (10 ... (00... 0)0101 ... 0(00 ... 0) ... 01) 11111 ...
(1010 ... 1) 111 ... in Écrits PARENTHÈSE
DES PARENTHÈSES 1966.
d)
le Graphe du Désir qui illustre cette anticipation, la règle
suivant le principe du feed-back cybernétique. Je rappelle son dessin
(fig.01 ci-contre). Si A est l'arrivée, la conclusion, le
produit de l'énoncé (sur le phrasé gauche>droite du bas), elle va
recevoir de s(A), son anticipation par un retour (feed-back) puisant à
l'énonciation (le phrasé gauche>droite du haut) où le pari du père
constitue la trace de A (notamment de sa perte pure dans le désir,
feed-back court par 'd'). C'est ce que j'indique en y plaçant la
succession 0000000000 suivant les conventions
de la Chaîne L : (10 ... (00... 0)0101 ... 0(00 ... 0) ... 01) 11111 ...
(1010 ... 1) 111 ... in Écrits PARENTHÈSE
DES PARENTHÈSES 1966.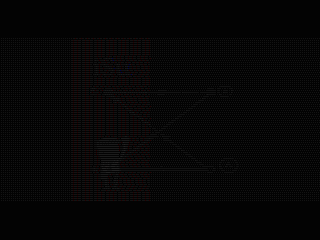 Je
ne peux troisièmement ajouter que des vues personnelles. J'ai franchement
appelé la substance de la horde "pluriel" - l'historique de l'usage
contemporain de ce mot vaudrait un rappel, mais pour rester bref, j'ai voulu en
faisant cela bénéficier du grand gain que permet l'assimilation du moi
freudien, que tu as bien décrit, au semblant, que l'on dira lacanien (en toute
spéciosité il faudrait le qualifier d'ab-lacanien). C'est ainsi que j'ai
prétendu « nous mettre à l’écoute de la horde » (en reprenant tes
termes).
Je
ne peux troisièmement ajouter que des vues personnelles. J'ai franchement
appelé la substance de la horde "pluriel" - l'historique de l'usage
contemporain de ce mot vaudrait un rappel, mais pour rester bref, j'ai voulu en
faisant cela bénéficier du grand gain que permet l'assimilation du moi
freudien, que tu as bien décrit, au semblant, que l'on dira lacanien (en toute
spéciosité il faudrait le qualifier d'ab-lacanien). C'est ainsi que j'ai
prétendu « nous mettre à l’écoute de la horde » (en reprenant tes
termes).